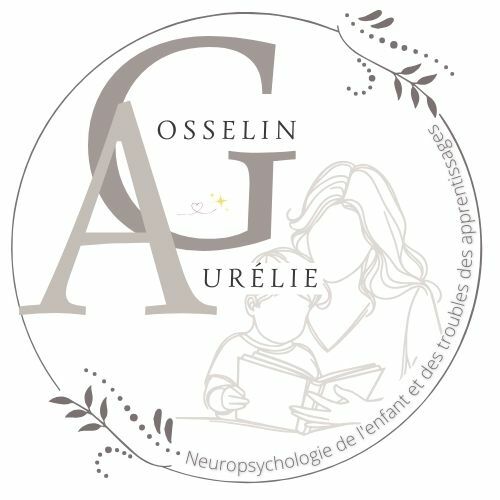Chroniques d'une psychopédagogue - Septembre 2025
La rentrée est arrivée. Pour beaucoup d’entre nous, c’est le retour à la réalité, au quotidien et à ses obligations. De mon côté, les souvenirs affluent et les questions avec. Je pense souvent aux années passées à enseigner, à ce que j’aurais fait différemment si j’avais eu les connaissances que m’ont apportées le DU et les formations suivies ces dernières années, à ce que j’aimerais transmettre aux parents, aux familles et aux enseignants.

« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir. », Auguste Comte
Cognition et apprentissages : Pourquoi faire le lien ?
Après le DU, j’ai suivi des formations tournées vers la psychopédagogie et les mécanismes d’apprentissage.
Au fil de ces formations, les notions de métacognition et de fonctions exécutives sont revenues souvent. Si je n’ai pas honte de dire que je n’avais jamais entendu ces termes dans l’enseignement, je suis aujourd’hui convaincue que cette approche, à laquelle je tiens beaucoup pendant mes séances, offre des outils de compréhension de soi et des autres.
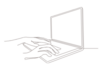
Apprendre à apprendre
N’a-t-on pas tous déjà vu cette formule mille fois ? Apprendre à apprendre. D’accord, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Je me souviens de certains de mes élèves, souvent les mieux intentionnés, qui faisaient des fiches pour apprendre. Ils faisaient de belles fiches, avec plein de couleurs, mais avec tellement, tellement de contenus qu’elles en étaient illisibles et inutilisables. Ou plutôt inutiles. C’était si frustrant, pour eux de ne pas réussir à appliquer ou à restituer la leçon, pour moi, de voir ces élèves qui se donnaient du mal en vain. Et surtout, j’ai été cette élève avant eux. Moi aussi, j’ai fait de belles fiches, j’ai recopié touuuutes mes leçons sur des fiches cartonnées. Et cela n’a pas toujours fonctionné.

Alors, est-ce que j’apprends aux enfants et aux élèves à faire des fiches ? Oui, parfois. Mais en réalité, c’est très rare. La fiche de leçons, le répertoire de mots, la fiche méthode sont des outils utiles et bien pratiques, de vraies béquilles pour qui sait les construire et les utiliser avec bon sens.
Mais pour en être capable, il faut pouvoir prendre du recul et analyser. Il faut être capable de se demander : Quelle stratégie ai-je employée et pourquoi elle n’a pas fonctionné ? Qu’est-ce que j’aurais pu faire autrement ? Qu’est-ce que je sais et de quoi ai-je besoin sur ma fiche ?
D’aucuns vous diront que je fais vraiment ma prof de maths mais, à titre d'exemple, à quoi sert une fiche avec les calculs du théorème de Pythagore si le problème vient du fait qu’il manque toujours la phrase en introduction de la démonstration ?
Cerner ses difficultés
Mes élèves, très souvent, me disaient « Je ne comprends pas pourquoi je n’y arrive pas ». Et, bien sûr, tout aussi souvent, la réponse des enseignants (et je ne garantirai pas que je ne l’ai jamais faite) tenaient en quelques mots : « Tu n’as qu’à apprendre tes leçons ». Mais, en réalité, la majorité du temps, l’élève en question est convaincu d’avoir appris cette leçon justement et surtout de l’avoir bien apprise. Alors, pourquoi, puisqu’il connaissait sa conjugaison par cœur, n’a-t-il pas réussi ce fichu contrôle ?
Récemment, j’ai eu un élève qui avait, justement, un contrôle sur le passé simple. Il était sûr de connaître sa leçon, il m’a mise au défi de l’interroger. Je lui ai proposé 20 conjugaisons, il en a réussi 6, toutes régulières. Quand je lui ai demandé : Quel est le problème ici ? Il m’a répondu qu’il ne savait pas, qu’il ne comprenait pas parce qu’il savait sa leçon. Alors, oui, il avait appris les tableaux, il avait mis les –s et les –ent au bon endroit mais il ne savait pas qu’on ne disait pas il vut ou tu mangas.

Il pensait que connaître son tableau suffisait, il m’a même dit que ce n’était pas grave, qu’il n’y aurait pas tant de verbes irréguliers dans le contrôle. En reprenant sa leçon, il a constaté que tous les verbes proposés y étaient. On a construit une fiche ensemble : les verbes irréguliers, leur radical, leurs particularités… Il a eu une bonne note à son contrôle.
Très souvent, l’élève connaît sa leçon. Ce sont les cas particuliers qu’il ne connait pas : les conjugaisons irrégulières, la réciproque de Pythagore ou de savoir expliquer pourquoi le document 1.b met en évidence une anomalie génétique sur le chromosome 21.
Inhiber ses réponses spontanées
Quand l’élève ne sait pas, il arrive qu'il raconte n’importe quoi, peut-être parce que l’être humain a horreur du vide. Ou peut-être parce qu’il y a toujours une chance que cela tombe juste. Et aussi, parce que, très souvent, il n’a même pas conscience du fait que sa réponse n’est pas adaptée.
J’ai un élève, que j’aime beaucoup, qui répond trois fois sur quatre à côté de la consigne. Vous lui demandez un synonyme de joli et il vous répond avec un antonyme. Vous lui donnez un problème de mathématiques et il répond avant même que vous ayez fini de lui lire. Vous lui proposez une devinette et il invente une histoire rocambolesque qui n’a, généralement, rien à voir avec la situation de départ. Au fond, il sait bien qu’il ne sait pas mais il n’a pas l’idée de chercher. Ou peut-être croit-il avoir l’intuition. Alors qu’il manque surtout d’inhibition.
Prendre conscience de ce défaut d’inhibition constitue souvent un déclic pour les élèves en séance. Et je regrette de ne pas avoir toujours su accompagner les élèves à cet égard, notamment parce qu’il est difficile, à l’écrit, de faire la différence entre défaut d’inhibition et défaut d’apprentissage.

Aujourd’hui, en séance, je prends le temps avec eux : J’ai entendu ta réponse, maintenant on reprend. Je t’ai demandé une fraction ou un nombre entier ? Est-ce qu’il y avait vraiment un chat dans l’histoire que je viens de te raconter ? Est-ce que tu n’as pas un peu modifié les données de l’énoncé ?
Parfois, à cette dernière question, ils me répondent : Ben si mais c’était plus simple !
Et la vraie victoire, c’est le jour où ils utilisent enfin l’énoncé pour répondre à ce qui était demandé !
Planifier sa réussite
Je me souviens des dernières années pendant lesquelles j’ai enseigné, je travaillais régulièrement avec les élèves de 3e sur des problèmes dits complexes, qui demandent d’être résolus en plusieurs étapes ou pour lesquels il faut faire le tri dans les informations. Je me rappelle de leur précipitation, de leur envie d’en finir avant d’avoir commencé. Et je me rappelle aussi de leur agacement quand je leur disais : Où allez-vous ? Qu’allez-vous faire en premier puis en deuxième ? Pourquoi dans cet ordre ?
Avec le recul, je me rends compte de la difficulté de cet exercice. Pouvoir planifier, construire sa réponse constitue en quelque sorte le niveau ultime de la métacognition. Si l’élève peut identifier, en amont, les étapes d’un raisonnement ou d’une résolution, alors il maîtrise vraiment son sujet, sa leçon et ce qu’on attend de lui. S’il est capable d’identifier les données, les informations, les contraintes pour rédiger un développement ou venir à bout d’un problème ou d’une analyse de documents, alors il est prêt.
Mais avant ça, avant d’être prêt, avant de savoir, il faut essayer. Il faut apprendre à construire, à chercher, à relier les informations entre elles pour avancer. Et c’est un travail qu’on sous-estime trop souvent en classe et à la maison, parce qu’il prend du temps. Apprendre à planifier, c’est apprendre à verbaliser, à expliquer.
Apprendre à planifier, c’est savoir exactement combien de mètres nous séparent de la ligne d’arrivée.
Prendre le départ
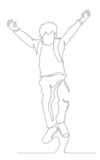
Parfois, le problème tient moins dans le fait d’apercevoir la ligne d’arrivée que de se positionner sur celle de départ. Et puis, surtout, de ne pas le rater. De ne pas le repousser indéfiniment, de ne pas se décourager parce que les obstacles paraissent un peu trop imposants.
En classe, je ne crois pas avoir pris conscience de l’importance du sentiment de compétence des élèves. Bien sûr, j’ai souvent demandé à ceux qui avaient le nez en l’air de s’y mettre : Tu attends que les autres aient fini ? Va falloir y aller, là… Si vous avez des questions, je suis là.

Sauf que, la plupart du temps, ils n’ont pas de question. La plupart du temps, ils ont besoin que l’adulte leur rappelle qu’ils savent faire ou plutôt ce qu’ils savent faire. Lis la consigne, identifie les verbes, qu’est-ce qu’on attend de toi ?
En séance, certains me disent même : Mais je ne sais pas comment commencer ! Et c’est là que tout se joue : pouvoir initier la réponse, la mise au travail, la recherche en prenant appui sur des choses simples, sur des techniques et des automatismes. Is ont besoin d’être rassurés pour prendre confiance et pouvoir commencer. Puis recommencer. Encore.
Aujourd’hui, j’aime l’idée de donner, aux enfants qui viennent me voir, les outils pour apprendre. Pas pour apprendre à apprendre mais pour bien apprendre, pour comprendre ce qu’est apprendre.
Envie d'en savoir plus sur les fonctions cognitives ou sur la façon dont je pourrais accompagner votre enfant ? Un avis à partager, des éléments pour compléter ? Je vous attends dans l'espace commentaires juste au-dessous !